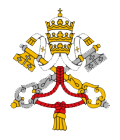NOSTRA AETATE, LA MAGNA CHARTA
DES RELATIONS ENTRE JUIFS ET CATHOLIQUES
Introduction à la conférence sur Nostra aetate à Paris le 8 octobre 2025
Kurt Cardinal Koch
« La religion juive n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais, dans un certain sens, elle appartient au cœur même de notre religion. Ainsi, nous avons avec elle une relation unique en son genre. Vous êtes nos frères privilégiés et, en un sens, nos frères aînés »[1]. Le pape Jean-Paul II a prononcé ces paroles incisives lors de sa visite à la synagogue de Rome le 13 avril 1986. Il formulait ainsi sa profonde conviction que la relation avec le peuple de l'alliance d'Israël faisait partie intégrante de la compréhension de soi de l'Église catholique et que, par conséquent, l'Église ne pouvait se comprendre sans référence au judaïsme. Rien ne saurait mieux exprimer la nouvelle attitude envers le judaïsme que la vision introduite par le Concile Vatican II avec sa déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, « Nostra aetate ». L'article 4, consacré au judaïsme, commence par cette phrase élémentaire : « Scrutant le mystère de l’Église, le saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d’Abraham ». Selon le Concile, le lien unique entre l'Église catholique et le judaïsme s'explique par deux raisons principales qui méritent d'être brièvement rappelées.
Premièrement, Nostra aetate est probablement né, au moins en partie, d'une initiative juive : la rencontre entre le pape Jean XXIII et l'historien juif Jules Isaac, le 13 juin 1960. Ce dernier lui remit un mémorandum l'exhortant à promouvoir une nouvelle perspective sur les relations entre l'Église et le judaïsme. Cette exigence d'une nouvelle perspective révèle l'une des motivations décisives qui ont conduit à la rédaction de Nostra aetate . Cette motivation résidait dans la nécessité de traiter du point de vue historique la tragédie de la Shoah, l’extermination des Juifs d'Europe, planifiée et exécutée avec une perfection industrielle par les nationaux-socialistes. Le cardinal Augustin Bea souligna cet important contexte historique de Nostra aetate avec ces mots clairs : « Le problème, vieux de près de deux mille ans, des relations entre l'Église catholique et le peuple juif – un problème aussi vieux que le christianisme lui-même – est devenu plus aigu, notamment en raison de l'extermination cruelle de millions de juifs par le régime nazi, et a donc nécessité l'attention du Concile Vatican II »[2].
Concrètement, cela signifie que l'Église catholique s'est également sentie obligée d'examiner attentivement sa coresponsabilité dans ces événements horribles. En guise de réponse chrétienne, l'Église doit reconnaître qu’un antijudaïsme théologique chrétien, en vigueur pendant des siècles, a nourri une aversion généralisée envers les Juifs, et qu'un héritage antijuif ancien est ancré dans l'âme de nombreux chrétiens. Ce lourd fardeau antijuif n'a certainement pas été la cause directe de la propagation de la haine antijuive national-socialiste, mais il a créé un prérequis mental qui a affaibli la résistance des chrétiens à la brutalité de la terreur national-socialiste.
Dans ce contexte, il est compréhensible que Nostra aetate condamne les comportements antisémites répréhensibles, et plus précisément « les haines, les persécutions et les manifestations d’antisémitisme, qui, quels que soient leur époque et leurs auteurs, ont été dirigées contre les Juifs », et déclare un « non » clair à toute forme d'antisémitisme. Ce « non » n'a rien perdu de sa pertinence, compte tenu de la montée inquiétante des tendances antisémites observée aujourd'hui dans divers pays. La conviction maintes fois exprimée par le pape François selon laquelle il est impossible d'être chrétien et en même temps antisémite reste donc plus que jamais d'actualité.
Deuxièmement, ce « non » catégorique à l'antisémitisme est lié dans Nostra aetate à un « oui » tout aussi ferme à l'héritage commun du judaïsme et du christianisme. Nostra aetate fait explicitement référence à l'image paulinienne de la « racine de l’olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l’olivier sauvage que sont les Gentils ». Cette image vise à rappeler que l'Église a reçu la révélation de l'Ancien Testament par « ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l’antique Alliance ». Cette image puissante, que Paul utilise au chapitre 11 de son Épître aux Romains, représente pour lui la perspective décisive pour considérer la relation entre Israël et l'Église de Jésus-Christ, et donc l'unité et la différence entre les deux communautés, à la lumière de la foi.
La déclaration Nostra aetate souligne non seulement les racines juives de la foi chrétienne, mais reconnait aussi positivement le « patrimoine spirituel commun » des juifs et des chrétiens. Du fait que l’Église ne peut « oublier le patrimoine qu’elle a en commun avec les Juifs », le véritable sens de la déclaration du Concile apparaît clairement, comme l'a exprimé le cardinal Augustin Bea, chargé de participer à la rédaction de Nostra aetate : Nostra aetate visait à « amener à nouveau ceux qui croient au Christ à une claire conscience des vérités sur les Juifs, présentées par l'Apôtre (c'est-à-dire Paul) et contenues dans le dépôt de la foi »[3].
Ce fondement de la nouvelle relation entre l'Église catholique et le peuple juif, inscrit dans l’histoire du salut, signifie concrètement que l'Église, en tant que Nouveau Peuple de Dieu, ne doit être comprise ni comme l'abolition, ni comme la substitution d'Israël comme Ancien Peuple de Dieu, mais plutôt comme son accomplissement. Pour les chrétiens, la Nouvelle Alliance n'est pas le remplacement, mais l'accomplissement de l’Ancienne Alliance. Car les deux sont liées dans une relation de promesse et d’accomplissement, ou plutôt d'anticipation. Cela suggère simultanément non seulement l'unité, mais aussi les différences entre le judaïsme et le christianisme, ainsi que l'interdépendance et le besoin réciproque entre l'Église et Israël en tant que peuple unique de Dieu, composé de Juifs et de Gentils.
Ces deux perspectives, le « non » catégorique à toute forme d'antisémitisme et le « oui » ferme au patrimoine spirituel commun, ont approfondi les relations entre l'Église catholique et le peuple juif au cours des soixante dernières années et enrichi le dialogue judéo-catholique. En témoignent les documents publiés par la partie catholique, les réponses de la partie juive au dialogue judéo-catholique et les dialogues officiels que l'Église catholique mène avec le « Comité juif international pour les consultations interreligieuses » (IJCIC) et le Grand Rabbinat de Jérusalem.
Ces perspectives restent pertinentes, surtout dans la situation actuelle, où ces relations sont perçues différemment pour des raisons politiques, et doivent être réaffirmées conjointement afin de poursuivre un chemin commun vers l'avenir. À cet égard, Nostra aetate représente certainement la Magna Charta des relations entre catholiques et juifs.
[1] Jean-Paul II, Discours à l'occasion de sa visite à la synagogue de Rome le 13 avril 1986.
[2] A. Kardinal Bea, Die Kirche und das jüdische Volk (Freiburg i. Br. 1966) 7.
[3] Relatio von Augustin Kardinal Bea über „Die Haltung der Katholiken zu den Nichtchristen und hauptsächlich zu den Juden,“ gehalten in der Konzilsaula am 19. November 1963, in: Ders., Die Kirche und das jüdische Volk (Freiburg i. Br. 1966) 141-147, zit. 144.