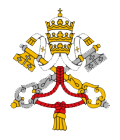JUIFS ET CHRÉTIENS, UNE AFFAIRE DE FAMILLE :
LES GRANDES ÉTAPES DU DIALOGUE
L´engagement des Papes, des gestes et des paroles
Discours à l´occasion de l´Inauguration de l´exposition
„Juifs et Chrétiens, une affaire de famille.
Les grandes étapes du dialogue. L´engagement des Papes, des gestes et des mots“
Paris, 9 octobre 2025
Cette année, l'Église catholique célèbre soixante ans de dialogue constant avec le judaïsme. Le 28 octobre 1965, le Concile Vatican II a promulgué la déclaration « Nostra aetate », dont le quatrième paragraphe représente le point de départ, la boussole et la « Magna Charta » du dialogue judéo-catholique, pour ainsi dire. Contrairement aux déclarations précédentes de l'Église, il s'agit d'une présentation clairement théologique de la relation entre le christianisme et le judaïsme, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Le N. 4 de « Nostra aetate » est un OUI résolu aux racines juives du christianisme et un NON tout aussi résolu à toutes formes d'antisémitisme. Il souligne le grand héritage spirituel du judaïsme au sein du christianisme et invite à le découvrir toujours davantage dans le dialogue mutuel.
Pour cette raison la date choisie aujourd'hui pour l'inauguration de cette exposition est donc tout à fait appropriée, car elle est proche de la date anniversaire du 28 octobre 2025. Le thème choisi souligne déjà que les soixante ans de dialogue judéo-catholique ont été marqués par des étapes importantes qui méritent d'être mentionnées et qui sont présentées dans cette exposition. En même temps, le titre lui-même établit une relation entre les juifs et les Chrétiens : il s'agit des affaires d'une seule et même famille. Que les juifs et les chrétiens appartiennent à la seule famille de Dieu, cela a déjà été souligné par le Pape François dans son discours à la synagogue de Rome le 17 janvier 2016 : «Dans le dialogue interreligieux, il est fondamental que nous nous rencontrions en tant que frères et sœurs devant notre Créateur et nous Le louions, que nous nous respections et apprécions mutuellement, et que nous essayions de collaborer. Et dans le dialogue entre judaïsme et christianisme, il existe un lien unique et particulier, en vertu des racines juives du christianisme... Nous appartenons tous à une unique famille, la famille de Dieu, laquelle nous accompagne et nous protège comme son peuple ».
Comme cette exposition se tient ici à Paris, les grandes étapes du dialogue judéo-catholique sont naturellement présentées dans une perspective française. D'un point de vue international, on peut toutefois souligner que les protagonistes français ont joué, dès le début, un rôle important dans ce dialogue. Il suffit de penser à la visite qu’a rendue le professeur d'histoire juif Jules Isaac au Pape Jean XXIII le 13 juin 1960. Il proposa, en présence du Saint Père, de reconsidérer les relations entre l'Église catholique et le judaïsme, notamment dans la perspective du concile Vatican II qui avait été annoncé. Et à sa question de savoir s'il pouvait nourrir un certain espoir après cet entretien, Jean XXIII a répondu : « Vous avez le droit d'avoir plus qu'un espoir ». Si l'on interroge les témoins de l'époque, la visite de Jules Isaac a effectivement constitué l'un des éléments déclencheurs qui incitèrent le Pape à proposer au Concile une déclaration sur les nouvelles relations entre l'Église catholique et le judaïsme.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France abrite la plus grande communauté juive d'Europe, si bien que la coexistence et la coopération entre Juifs et Chrétiens ont toujours revêtu une grande importance. Tant du côté catholique que du côté juif, de nombreux protagonistes se sont engagés avec courage dans le dialogue judéo-catholique, comme par exemple Charles Péguy, le rabbin René-Samuel Sirat, Theo Klein, Edmond Fleg, Jacques Maritain, le cardinal Roger Etchégaray, le cardinal Jean-Marie Lustiger, le père Bernard Dupuy et le Père Jean Dujardin. En outre, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, a été fondée le 26 février 1948 « l'Amitié judéo-chrétienne » qui compte parmi ses membres fondateurs Jules Issac et Edmond Fleg.
Lorsque l'Église catholique aborde les grandes étapes du dialogue judéo-catholique, les initiatives prises par les Papes depuis l'adoption de « Nostra aetate » en 1965 revêtent naturellement une importance particulière. Les juifs considèrent Jean-Paul II comme le « grand briseur de glace » du dialogue judéo-catholique, car il a été le premier à accomplir des gestes d'amitié inoubliables envers les juifs. Si le Pape Paul VI avait déjà pris des mesures décisives pour se rapprocher du judaïsme, ce n'est que sous Pape Jean-Paul II que l'engagement de la Curie romaine à cet égard a été vraiment perçu. Pour des raisons purement biographiques, il lui tenait particulièrement à cœur d'améliorer les relations avec le judaïsme. Karol Wojtiła a grandi dans la petite ville polonaise de Wadowice, où un quart de la population était juive. Dès son plus jeune âge, il lui semblait tout naturel de côtoyer ses concitoyens juifs et de participer à leur vie quotidienne. C'est pourquoi il tenait personnellement à nouer et à intensifier les liens d'amitié avec le judaïsme, même en tant que Pape. Dès la première année de son pontificat, le 7 juin 1979, il se rendit au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où il rendit un hommage particulier aux victimes de la Shoah devant la pierre commémorative portant une inscription en hébreu. Mais sa visite à la synagogue de Rome le 13 avril 1986 fut encore plus spectaculaire et médiatisée. L'image de l'étreinte entre le grand rabbin Elio Toaff et le Pape Jean-Paul II devant le « Tempio Maggiore » de Rome fit le tour du monde. Pour la première fois dans l'histoire, un Pontife Romain se rendait dans une synagogue pour exprimer son estime envers le judaïsme devant le monde entier. Une autre étape très importante pour les Juifs a été franchie fin décembre 1993 avec la pleine reconnaissance diplomatique de l'État d'Israël par le Saint-Siège ; un échange d'ambassadeurs eut lieu l'année suivante.
Enfin, dans le contexte du document publié en 1998 par la Commission vaticane pour les relations religieuses avec le judaïsme, « Nous nous souvenons : une réflexion sur la Shoah », il convient de mentionner la prière de pardon du Pape le 12 mars 2000, dans laquelle il demandait pardon pour les fautes commises à l'égard du « peuple d'Israël » lors d'une liturgie publique dans la basilique Saint-Pierre. Lors de sa visite en Israël, le 26 mars 2000, Jean-Paul II a ensuite glissée cette demande légèrement modifiée, dans une prière écrite, entre les pierres du Mur des Lamentations. Sa visite dans l'État d'Israël peut être qualifiée d'historique et considérée comme une initiative unique pour la promotion du dialogue judéo-catholique. Il s’est rendu au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem, commémoré les victimes de la Shoah et prié pour elles, il a rencontré des survivants de cette tragédie sans pareille, participé à une rencontre interreligieuse avec des musulmans et pris contact, pour la première fois, avec le Grand Rabbinat de Jérusalem. Le Pape Jean-Paul II recevait d'ailleurs fréquemment des personnalités et des groupes juifs au Vatican, et lors de ses nombreux voyages pastoraux, une rencontre avec une délégation juive locale faisait toujours partie du programme obligatoire. Si l'on considère le grand engagement de ce Pape en faveur du dialogue judéo-catholique, on peut affirmer son long pontificat a tracé les jalons de l'avenir de ce dialogue. Il ne peut y avoir de retour en arrière par rapport à ce qui a été accompli pendant son pontificat, d'autant plus que « Nostra aetate » (N. 4) a établi des directives claires qui restent incontestablement valables.
Si nous considérons les huit années du pontificat du Pape Benoît XVI, nous pouvons constater qu'au cours de cette brève période, il a essentiellement accompli les mêmes avancées que le Pape Jean-Paul II en 27 ans. Il a reçu d'innombrables délégations juives au Vatican et, au cours de ses voyages, il s'est rendu à Auschwitz-Birkenau le 28 mai 2006. Il s'est également arrêté devant le Mur des Lamentations lors de sa visite en Israël en mai 2009, a pris contact avec le Grand Rabbinat de Jérusalem et avec les représentants du judaïsme d'Israël et du monde entier, a prié pour les victimes de la Shoah à Yad-VaShem et a été accueilli par la communauté juive romaine dans leur synagogue le 17 janvier 2010. Il a accordé une attention particulière au dialogue avec les juifs, dans une perspective de réconciliation.
Le Pape François était lui-même déjà un « fils de Nostra aetate » lorsqu'il pratiquait et encourageait activement le dialogue judéo-catholique à Buenos Aires, où les relations entre les juifs et l'Église catholique étaient très bonnes. En très peu de temps, il a pris les mêmes mesures à Rome que ses deux prédécesseurs. Au Vatican, il a progressivement reçu de nombreux groupes juifs et des rabbins à titre individuel, et lors de ses voyages, il a rencontré à plusieurs reprises des représentants du judaïsme. Il a effectué un voyage en Israël dès la deuxième année de son pontificat, où il a prié devant le Mur des Lamentations le 26 mai 2014, il a rencontré les deux grands rabbins d'Israël, rendu hommage aux victimes de la Shoah à Yad Vashem et parlé avec des survivants de cette catastrophe humaine. Le 17 janvier 2016, il s'est rendu à la synagogue de Rome, où il a évoqué notre appartenance commune à la grande famille de Dieu et exprimé sa gratitude pour les progrès accomplis jusqu'à présent dans le dialogue judéo-catholique. Enfin, lors de son voyage à Cracovie pour les Journées mondiales de la jeunesse, le 29 juillet 2016, le Pape François s'est également rendu au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, où il n'a pas prononcé de grand discours, mais a prié en silence et en toute humilité pour les victimes de la Shoah. Les mots peuvent souvent conduire à des malentendus, mais les prières remettent tout entre les mains de Dieu. Le style du Pape François dans le dialogue judéo-catholique a généralement été caractérisé par une immense humanité et une empathie immédiate.
Je suis convaincu que le Pape Leo XIV va continuer cet important dialogue, comme le Pape l`a promis pendant sa première rencontre avec les représentants d´autres religions le 19 mai 2025 : « Le dialogue théologique entre chrétiens et juifs reste toujours important et me tient très à cœur. Même en ces temps difficiles, marqués par des conflits et des malentendus, il est nécessaire de poursuivre avec élan ce dialogue si précieux. » C´est aussi le Pape Leo XIV qui présidera l´anniversaire des soixante ans de « Nostra aetate » (N. 4) au Vatican le 28 octobre.
Ce jubilé nous invite à réfléchir au chemin parcouru et aux différentes étapes du dialogue judéo-catholique, et à rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été accompli. Sans la prière insistante et l'assistance divine, aucun dialogue ne peut aboutir, car Dieu est en soi un dialogue perpétuel. Même si la situation politique actuelle rend le dialogue officiel difficile et compliqué nous ne devons pas renoncer à entretenir nos amitiés personnelles entre chrétiens et juifs. Nous prions donc notre Dieu de nous aider dans nos efforts de dialogue et de nous accorder un avenir radieux.